La participation citoyenne peut-elle être institutionnalisée ?
Note de recherche scientifique
Publié le 28.10.2025 à 17h03
Mis à jour le 05.02.2026 à 15h27
Un dispositif délibératif permanent peut-il être envisagé dans le paysage institutionnel du Luxembourg ? Quelles sont les leçons à tirer des recommandations issues des évaluations scientifiques des expériences pilotes menées en 2021 et en 2022, respectivement le Biergerkommitee Lëtzebuerg 2050 (BK2050) et le Klima-Biergerrot (KBR). Quels enseignements peut-on tirer des dispositifs délibératifs permanents en Europe? Cette recherche, portant sur la faisabilité d’un dispositif délibératif permanent à l’échelle nationale au Luxembourg, a été réalisée en collaboration avec Dr Raphaël Kies et Dr Emilien Paulis de l’Université de Luxembourg.
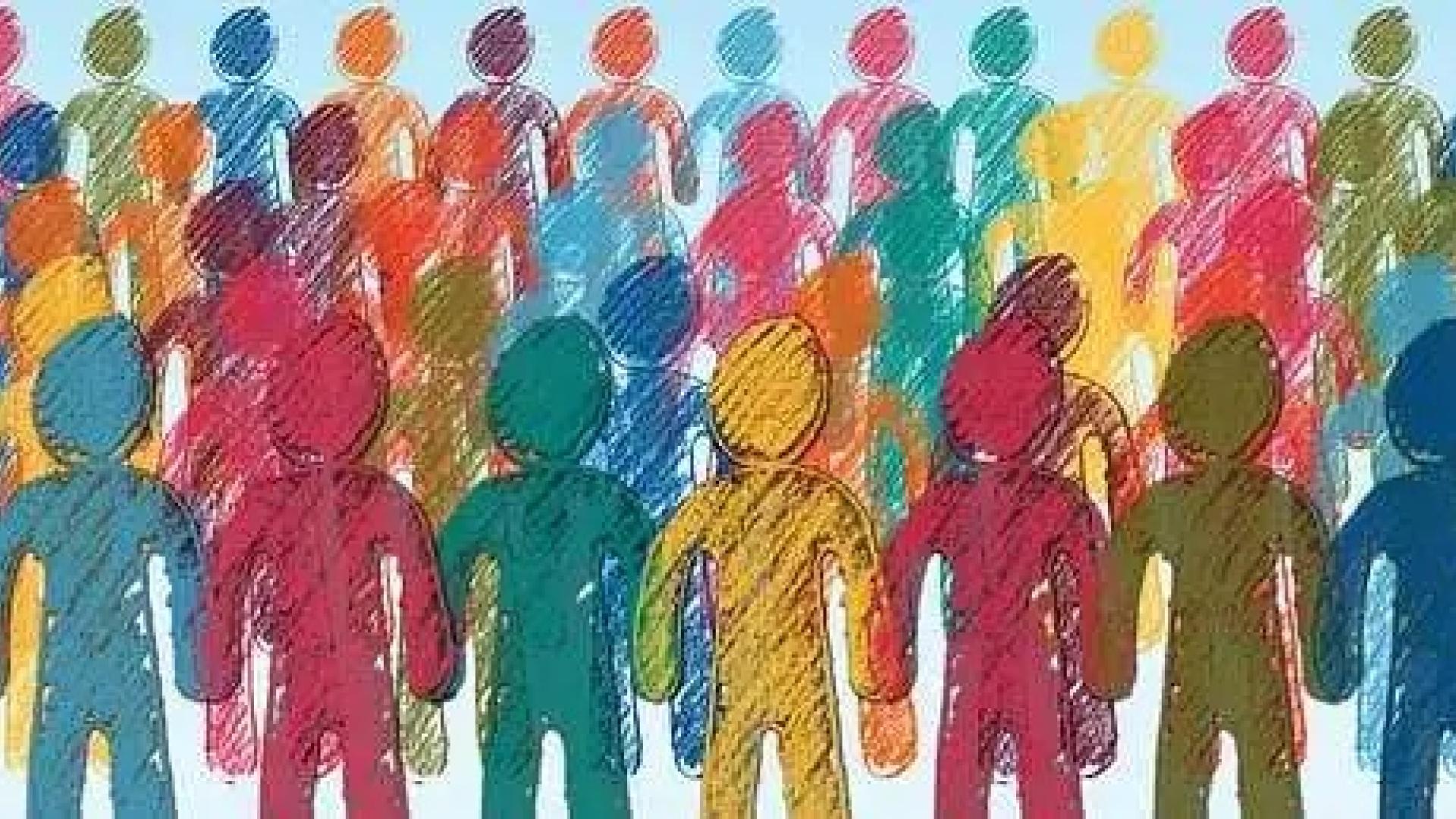
- La présente étude examine la faisabilité d’un dispositif délibératif permanent au Luxembourg. Elle dresse un état des lieux des pratiques existantes au Luxembourg, mettant notamment en évidence les recommandations issues des évaluations scientifiques des expériences pilotes menées en 2021 et en 2022, respectivement le Biergerkommitee Lëtzebuerg 2050 (BK2050) et le Klima-Biergerrot (KBR).
- En effet, face à la demande croissante de participation citoyenne et à l’érosion de la confiance dans les institutions représentatives, de nombreux pays européens explorent de nouveaux modèles d’inclusion démocratique. Le Luxembourg n’échappe pas à cette dynamique : des initiatives participatives locales et nationales y ont été expérimentées. Ces dispositifs illustrent le potentiel des assemblées citoyennes tirées au sort, mais posent également la question de leur pérennisation.
- Il ressort des sondages d’opinion menés au Luxembourg, que les citoyens se montrent majoritairement favorables à une utilisation plus fréquente des assemblées citoyennes, tandis que les partis politiques, bien que parfois prudents, reconnaissent leur utilité comme complément à la démocratie représentative.
- L’étude repose également sur l’analyse comparative de huit dispositifs délibératifs institutionnalisés en Europe (Belgique, France, Allemagne, Autriche, Union européenne), allant de modèles fortement institutionnalisés à des expériences encore en cours d’élaboration. Leur ancrage géographique varie : certains sont régionaux (notamment en Belgique et en Autriche), d’autres nationaux (France, Allemagne), et un est supranational (Union européenne).
- Les modèles étudiés sont également variés en ce qui concerne leur pérennité et le degré d’institutionnalisation : le dialogue citoyen permanent en Communauté germanophone (Belgique) est le plus intégré juridiquement et politiquement, tandis que les panels européens restent sans base légale formelle.
- L’analyse comparative est porteuse de plusieurs enseignements clés : le rôle clé joué par les parlements tant dans l’initiation que dans le suivi des dispositifs délibératifs, la nécessité d’une gouvernance autonome par l’établissement d’un organe dédié, la rigueur dans la sélection des participants, et l’existence de mécanismes de suivi politique.
- La majorité des dispositifs comparés a une fonction strictement consultative, qui se présente comme un complément de la démocratie représentative. La conception de ces dispositifs n’entend donc pas supplanter le modèle traditionnel de démocratie représentative.
- L’impact de ces dispositifs dépend fortement du suivi et de la volonté politique. Certains cas, comme le dialogue citoyen permanent en Communauté germanophone de Belgique, démontrent qu’une intégration institutionnelle bien conçue peut produire des effets concrets sur les politiques publiques.
- L’analyse comparative ne permet pas d’identifier un modèle directement transposable au Luxembourg. Toutefois, elle met en lumière plusieurs options, que cette étude évalue à travers les spécificités locales, sociétales, politiques et juridiques, pour proposer les solutions les plus adaptées.
- La réussite d’un dispositif délibératif permanent au Luxembourg dépend de plusieurs conditions :
- Une volonté politique claire et transpartisane : L’instauration d’un dispositif délibératif permanent suppose un engagement fort de la part des autorités parlementaires et gouvernementales. Cela passe notamment par l’inscription du dispositif dans un cadre juridique stable, afin d’en garantir la continuité au-delà des alternances politiques.
- Une gouvernance autonome et crédible : L’indépendance du dispositif par rapport aux pouvoirs législatif et exécutif est essentielle pour garantir sa légitimité. La création d’un Conseil citoyen permanent, chargé de veiller au bon déroulement des processus délibératifs et de proposer des thématiques de délibération, pourrait être une solution à considérer.
- Une attention particulière à l’inclusivité : Le tirage au sort pourrait s’accompagner d’une stratification sociodémographique rigoureuse pour assurer la représentativité. Cela pourrait être renforcé par des mesures spécifiques pour lever les barrières matérielles et symboliques à la participation : défraiement, accessibilité, multilinguisme, accompagnement des publics fragiles, etc.
- Un cadre délibératif robuste : La qualité des débats repose sur la présence de facilitateurs formés, d’un appui scientifique pluraliste et d’un calendrier suffisamment souple pour permettre une montée en compétence des participants.
- Un mécanisme de suivi clair : La force d’un dispositif délibératif réside dans sa capacité à influencer, même indirectement, les politiques publiques. Des procédures de suivi transparentes, incluant des réponses motivées des institutions et la participation de comités citoyens de suivi, pourraient donc être intégrées dès le départ.
- Une transparence et une évaluation continue : Pour préserver la confiance, garantir un accès public aux travaux, aux recommandations et aux réponses politiques serait crucial. Sur le plus long terme, une évaluation continue, à des fins d’apprentissage collectif, serait également pertinente pour améliorer le dispositif délibératif mis en place.
- Une communication proactive : Informer et sensibiliser la population sur le fonctionnement et les résultats du dispositif est essentiel pour son appropriation sociale. Une stratégie de communication, en lien avec les médias et les acteurs de la société civile, pourrait accompagner le processus à chaque étape.
- En somme, le Luxembourg dispose d’un socle favorable pour l’instauration d’une assemblée citoyenne permanente. En s’inspirant de pratiques européennes existantes et en tenant compte de ses propres spécificités sociétales, le Luxembourg pourrait construire un modèle robuste, inclusif et légitime, susceptible de renforcer la confiance démocratique et d’innover le dialogue entre citoyens et institutions.
Retrouvez l'étude complète :
Find the complete study in English :





